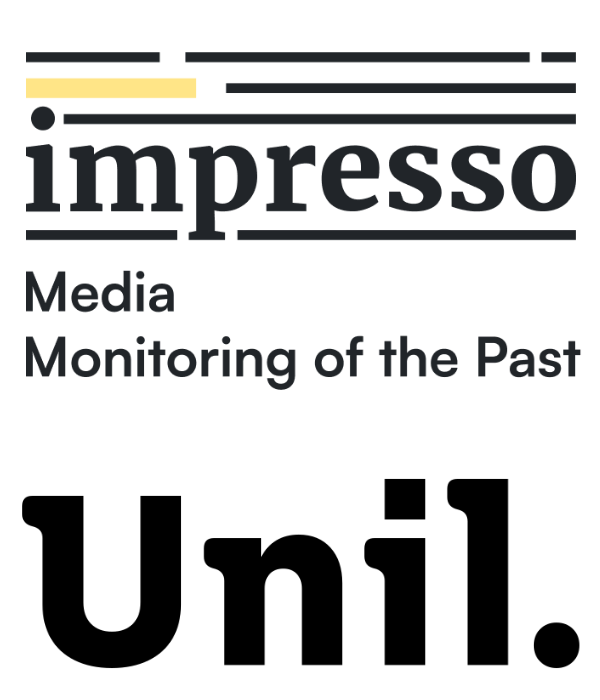Radio et journaux : quels croisements pour l’histoire des médias ?
30 juin - 1e juillet 2026
Colloque international
Université de Lausanne, Switzerland
 Journalistes dans la salle des nouvelles de Radio-Canada/CBC à Montréal, 30 novembre 1944
Journalistes dans la salle des nouvelles de Radio-Canada/CBC à Montréal, 30 novembre 1944
(photo Conrad Poirier, Bibliothèque et Archives nationales du Québec, Wikimedia Commons).
Appel à communications
Argumentaire
Dans le prolongement de nos réflexions sur l’approche transmédia, cette conférence internationale – organisée par le projet Impresso et la Section d’histoire de l’Université de Lausanne – ambitionne de dépasser la lecture traditionnelle des relations entre presse écrite et radio. En tant que deux principaux médias d’information du XXe siècle, leur relation a souvent été réduite dans la littérature à une simple concurrence institutionnelle. Cette conférence vise à mettre en lumière la complexité de ces relations, en soulignant notamment les influences réciproques en termes de contenus et de formats, la circulation des acteurs et des pratiques entre les deux médias, ainsi que leurs représentations et usages croisés. Par ailleurs, l’un des objectifs centraux de cette rencontre est d’explorer les nouvelles perspectives de recherches transmédias offertes par les outils numériques dans un contexte de numérisation croissante des archives de presse et de radio.
Cette initiative fait suite à la conférence “Transmedia History: Circulations, Reconfigurations and New Methodologies”, organisée à Lausanne en janvier 2025, et dont le Book of Abstracts est disponible en ligne: 10.5281/zenodo.15052470. Un numéro spécial de TMG Journal of Media History intitulé “Transmedia Histories” est également en préparation.
Bien que ces dernières années, plusieurs perspectives aient été proposées pour dépasser cette approche en silo (transmédia, cross-média, convergence…), l’historiographie des médias de masse s’est longtemps construite sur une approche cloisonnée des différents médiums. Cela est particulièrement vrai pour les travaux consacrés à la presse, où la radio est rarement mentionnée ou alors de manière très ponctuelle (Delporte et al., 2016 ; Hampton, 2004 ; Koss, 1984). À l’inverse, la radio est traditionnellement plus régulièrement étudiée en lien avec d’autres médias, notamment avec la télévision dans le cadre de travaux plus larges portant sur l’audiovisuel public (Jeanneney, 2001; Drack, 2000; Mäusli et Steigmeier, 2006; Mäusli, Steigmeier et Vallotton, 2012), mais aussi avec la presse, en raison de l’influence qu’a exercé ce secteur lors des débuts de la radiodiffusion (Arceneaux, 2019). Les moments où la presse et la radio sont mises en relation relèvent principalement d’un contexte de rivalité : dans les années 1920, l’émergence de la radio, capable d’atteindre le public de manière plus immédiate, suscite l’inquiétude des éditeurs de journaux. Ceux-ci tentent alors soit de freiner son développement, en revendiquant notamment un monopole sur la collecte de l’information et en imposant des restrictions sur la publicité, dans le but de préserver leur position commerciale face à cette nouvelle technologie, soit en cherchant à superviser son développement, voire en devenant eux-mêmes propriétaires de stations (Stamm, 2011). Cette rivalité a donné lieu à de nombreuses négociations institutionnelles au fil du temps comme lors des processus de libéralisation de l’audiovisuel (Sandoz, 2025, 153-188), et elle ne s’est pas éteinte : elle s’exprime notamment, ces dernières années, autour de la production de contenus numériques par les radiodiffuseurs publics.
Ces fortes tensions, tout à fait centrales, ont pris le pas dans l’historiographie sur les autres formes d’interactions qui existent entre la presse et la radio et qui demeurent encore à explorer. Si presse et radio diffèrent profondément par leurs supports (écrit vs. oralité), leurs contraintes technologiques, leurs modes de production et de distribution ou encore leurs conditions d’archivage, qui posent des défis spécifiques en termes de conservation et d’accès et qui compliquent leur analyse conjointe, ces deux médias ont toujours évolué dans ce que Siân Nicholas appelle une “culture de l’intermédialité”/”the culture of intermediality” (2012). Celle-ci se manifeste par des convergences stylistiques, une interdépendance croissante des contenus (notamment à travers des emprunts réciproques), ainsi que par des circulations de personnel. Une telle perspective invite à concevoir une “histoire intégrée des médias”/”an integrated history of the mass media”, attentive aux interactions et aux coévolutions entre médias tout au long de leur développement (Nicholas, 2012, 383).
C’est cette “histoire médiatique interconnectée”/”this interlinked media history” (Nicholas, 2012, 383) — dont les racines sont antérieures à la massification de la radio (Arceneaux, 2014) — que ce colloque souhaite explorer. Au-delà des logiques de concurrence, nous invitons à analyser les interactions complexes et les interdépendances entre presse écrite et radio. L’objectif est de mettre en lumière les dynamiques transmédias à l’œuvre, en mobilisant des outils et approches (par exemple numériques) susceptibles d’enrichir la réflexion théorique et méthodologique sur l’histoire des médias. Notre ambition est ainsi de proposer une histoire décloisonnée et entremêlée de la presse et de la radio, en les inscrivant dans un cadre social, politique et culturel élargi (Cronqvist et Hilgert, 2017).
Dans cette perspective, nous souhaitons réunir des contributions sur l’histoire croisée de la presse et de la radio autour de trois axes de recherche principaux :
Axe 1. Contenus et formats – entre influences réciproques et processus de remédiation
Le premier axe vise à identifier et à analyser les nombreuses manières dont la presse et la radio se sont mutuellement influencées tout au long du XXe siècle, que ce soit au niveau des contenus diffusés ou des formats médiatiques adoptés. Au-delà d’une lecture en termes de rivalité ou de concurrence, il s’agit d’explorer les dynamiques d’interdépendance, d’imitation, de réappropriation ou de transformation réciproques. Dès les débuts de la radiodiffusion, des éditeurs de presse ont joué un rôle actif dans la création et le parrainage d’émissions, tandis que les agences de presse ont joué un rôle déterminant pour le contenu radiophonique en étant souvent la principale et/ou seule source d’information. La radio s’est largement inspirée de la presse pour structurer ses programmes et formats, comme les bulletins d’information ou les “magazines” radiophoniques. Cependant, l’influence entre presse et radio a été réciproque. En retour, la presse a adopté le vocabulaire et le style de la radio pour dynamiser ses rubriques, intégrant même des éléments discursifs typiques des émissions radiophoniques. Par ailleurs, la presse a progressivement adapté son contenu, consciente que ses lecteurs avaient souvent déjà entendu les informations à la radio. Cela a conduit à une redéfinition de son rôle, davantage axé sur l’analyse et l’opinion. La forme même des articles a évolué : titres raccourcis, mise en page allégée, paragraphes brefs — des changements attribués à l’influence des formats concis de la radio, notamment des bulletins.
Ces influences réciproques se manifestent aussi dans l’évolution parallèle de formats médiatiques spécifiques : ainsi, le genre de l’interview, né dans la presse comme une tentative de restitution orale, a été transposé à la radio avec ses propres codes (Willem, 2020). De même, la satire s’est développée dans les deux médias, passant de la caricature imprimée aux pastiches radiophoniques, tout comme la publicité a connu des déclinaisons propres à chaque support (Morillas, 2005). Dans certains cas, ces formes évoluent au point d’opérer des glissements médiatiques complets, comme lorsque certaines émissions radiophoniques donnent naissance à des titres de presse (Kaenel, 2021). La circulation des modèles journalistiques et des pratiques éditoriales illustre les liens profonds qui unissent les deux médias. L’objectif de cet axe est donc de comprendre les mécanismes par lesquels les messages sont reformulés, reformatés, adaptés, ou retravaillés d’un médium à l’autre. Ce phénomène de “remédiation” — tel que défini par Bolter et Grusin (2000) — montre comment chaque média s’inscrit dans un réseau d’imitations, de détournements et de réinterprétations d’autres médias. Si ce concept de “remédiation” a d’abord été pensé pour l’ère numérique, il s’applique tout autant aux relations historiques entre presse et radio. Les nouveaux médias ne remplacent pas les anciens : ils les reconfigurent et les intègrent dans de nouveaux cadres expressifs.
Dans cet axe, les propositions pourront par exemple aborder les questions suivantes:
- Quels acteurs et quelles dynamiques économiques, politiques et/ou techniques ont favorisé ou freiné ces processus d’hybridation?
- Comment les logiques éditoriales et les contraintes matérielles ont-elles influencé la reconfiguration des formats ?
- Quels transferts de styles, de vocabulaires, de genres ou de rythmes observe-t-on entre ces deux médias ?
- En quoi le concept de remédiation permet-il de renouveler l’analyse des relations entre médias ?
Axe 2. Acteurs et pratiques – des circulations et des convergences
Le deuxième axe vise à interroger les dynamiques de passage entre la presse et la radio et vice-versa, qu’il s’agisse de parcours professionnels individuels ou de pratiques journalistiques. Il met l’accent sur les phénomènes de circulation et de convergence qui, loin de constituer des exceptions, structurent profondément les écosystèmes médiatiques déjà avant l’ère numérique.
Les trajectoires individuelles révèlent une forte perméabilité entre les deux univers médiatiques (Valsangiacomo, 2015). Nombre de professionnels (chroniqueurs, éditorialistes, reporters ou critiques – sportifs, cinématographiques ou culturels) naviguent d’un média à l’autre ou exercent simultanément pour plusieurs médias. Certains directeurs ou responsables de programmes radiophoniques viennent eux-mêmes du monde de la presse. Ces mobilités professionnelles s’inscrivent dans l’émergence d’“une communauté professionnelle médiatique”/“this professional media community” (Nicholas, 2012, 388), marquée par des circulations intermédiatiques de personnel et par la constitution de cercles de sociabilité qui renforcent ces logiques d’interdépendance.
En parallèle, les pratiques professionnelles font elles aussi l’objet d’appropriations croisées. Le processus de convergence des médias, qu’il soit économique ou technologique (Sparviero, Peil et Balbi, 2017), favorise le développement de savoir-faire transférables. Ces logiques sont perceptibles tant dans le passé que dans les pratiques contemporaines du journalisme. Des expériences telles que les Radio Photologues du Chicago Daily News, au début du XXe siècle, témoignent de formes précoces de journalisme multimédia, combinant texte, son et image (Good, 2017). Elles invitent à envisager la convergence comme une dynamique historique récurrente et non comme un phénomène linéaire et propre à l’émergence du numérique. Cette interdépendance des formes de médias n’est pas nouvelle en soi, mais s’accélère ces dernières années et prend de nouvelles formes à l’ère numérique.
Dans cet axe, les propositions pourront par exemple aborder les questions suivantes :
- Comment évolue l’identité de “journaliste” dans un contexte d’irruption d’un nouveau média ? Comment la communauté professionnelle se réorganise-t-elle pour s’adapter à ces nouveaux métiers ?
- Quel est le profil des individus qui incarnent personnellement la convergence entre presse et radio ? S’agit-il de carrières typiques ou, au contraire, de trajectoires remarquables ?
- Au-delà des contenus médiatiques eux-mêmes, qui constituent la face visible de la convergence, quels sont les processus institutionnels et économiques qui expliquent ces rapprochements ?
- En quoi la convergence numérique redéfinit-elle les frontières entre radio et presse, tant sur le plan des pratiques rédactionnelles que des processus de production ?
Axe 3. Discours et représentations réciproques – vers une hybridation des usages
Le troisième axe se penche sur les représentations réciproques que la radio et la presse se sont construites, ainsi que sur les usages croisés qu’en font les publics. Il s’agit de mieux comprendre, d’une part, comment presse et radio – loin d’évoluer en silos – se définissent en miroir et s’influencent sur le plan symbolique et, d’autre part, comment leurs publics en font des usages complémentaires.
Les discours produits par les médias à propos de leurs concurrents ou partenaires sont un terrain d’observation privilégié des dynamiques intermédiales. La presse écrite, par exemple, a très tôt posé un regard sur la radio à travers ses critiques, ses chroniques spécialisées ou ses pages spéciales, contribuant ainsi à façonner l’image publique de la radiodiffusion tout en consolidant sa propre autorité et en répondant à un intérêt croissant du public pour des pages “divertissement” (MacLennan, 2012). Inversement, certaines émissions radiophoniques ont mis en scène la presse, l’ont citée ou analysée, brouillant les frontières entre les deux supports. Ces représentations croisées témoignent à la fois d’une volonté de positionnement concurrentiel et d’une logique de complémentarité. Les perceptions, qui circulent entre les deux médias, constituent autant de clefs de lecture pour saisir la façon dont ces derniers légitiment leurs rôles respectifs dans l’espace public. Au-delà des discours, ce sont aussi les formes matérielles de l’hybridation qui seront au centre de cet axe : magazines radiophoniques, revues de presse à la radio, publicités croisées ou publications spécialisées comme The Listener, ou Radio Times ou Hör Zu illustrent la manière dont un média peut servir de support à la promotion ou à la mise en récit de l’autre. Les logiques de collaboration commerciale ou institutionnelle entre éditeurs de presse et radiodiffuseurs, notamment pour la publication des grilles de programmes ou la production de suppléments, ont joué un rôle déterminant dans la structuration de cet espace médiatique hybride.
Cette porosité entre les deux sphères médiatiques reflète une culture commune, mais aussi une dynamique d’adaptation mutuelle aux normes et attentes des différents publics. Cet axe invite également à interroger les pratiques d’usage convergent des médias dans les foyers. Ces pratiques de consommation médiatique croisée révèlent la manière dont les publics investissent les différents médias de façon complémentaire, dans une “utilisation convergente des médias”/”convergent media use” (Müller et Röser, 2017) simultanée ou séquencée, et évoluent dans des environnements transmédiatiques.
Dans cet axe, les propositions pourront par exemple aborder les questions suivantes:
- Comment l’avènement de la radio a-t-il été annoncé et perçu par la presse déjà en place?
- Comment ces deux médias popularisent-ils le contenu de l’autre média, le promeuvent-ils ou le critiquent-ils?
- Comment les journaux, en tant que support papier, servent-ils les objectifs/intérêts de la radio et, inversement, comment le support audio (la radio) peut-il être utilisé pour servir la presse ?
- Comment les publics s’approprient-ils les contenus issus de la presse et de la radio dans des environnements médiatiques hybrides ?
- Dans quelle mesure et à quels degrés observe-t-on une utilisation convergente des médias au sein des foyers ? Dans quelle mesure cette tendance s’accentue-t-elle à l’ère numérique ?
En mobilisant une approche croisée de l’histoire de la presse et de la radio, les contributions réunies dans ce colloque permettront d’amener de nouveaux éléments sur l’histoire des deux médias, tout en explorant les perspectives inédites qu’offrent la numérisation massive des archives et les méthodes computationnelles pour écrire une histoire transmédia. Elles mettront également en lumière la culture de l’intermédialité dans laquelle ces supports se sont toujours inscrits, sans occulter pour autant les profondes divergences et les tensions persistantes entre presse écrite et audiovisuel, dans un contexte marqué par de nombreux défis économiques et techniques.
L’objectif de cette manifestation scientifique étant de contribuer à la clarification et au développement de l’approche transmédia dans une perspective historique et, plus largement, à promouvoir une histoire décloisonnée de la presse et de la radio, nous encourageons les contributions de chercheurs, juniors et seniors, qui souhaitent partager leurs approches empiriques et méthodologiques dans ce domaine.
Informations pratiques
La conférence se tiendra à l’Université de Lausanne, en présentiel et sera retransmise en ligne par Zoom pour le public. Pour les contributrices et contributeurs, la présentation à distance (via Zoom) sera possible seulement en cas de nécessité et sur demande explicite.
Les langues de travail du colloque seront l’anglais et le français. Les intervenantes et intervenants qui s’exprimeront en français seront priés d’accompagner leur présentation de diapositives en anglais.
Les papiers sélectionnés seront publiés dans un ouvrage collectif en Open Access.
S’ils ne peuvent être couverts par l’institution qui les emploie, les frais de déplacement et d’hébergement des participantes et des participants pourront être pris en charge (en totalité ou en partie, en fonction du nombre de demandes) sur demande explicite. Nos moyens étant limités, la priorité sera donnée aux jeunes chercheuses et chercheurs.
Modalités de soumission et calendrier
Lundi 10 novembre 2025 : Les propositions doivent être soumises via Sciencesconf. Les propositions (750 mots max.) comporteront un titre, une problématique indiquant clairement les résultats obtenus/attendus, une bibliographie (5 références max.); merci d’y joindre une courte notice bio-bibliographique (150 mots max.). Dans Sciencesconf, veuillez utiliser la section “RésuméTitle and abstract” pour entrer votre proposition en plein texte: le résumé, ses références et la note bio-bibliographique peuvent être insérés dans le même champ. Pas besoin de produire un PDF.
Décembre 2025 : Notifications d’acceptation après un processus de sélection conduit avec l’aide des membres du Comité scientifique.
Fin mai 2026 : Pour les personnes intéressées à prendre part au projet de publication, envoi d’un papier d’environ 6’000 mots.
30 juin - 1er juillet 2026 : Colloque international sur le campus de l’Université de Lausanne, Suisse.
Fin août 2026 : Remise des papiers sélectionnés pour la publication.
Comité d’organisation
Raphaëlle Ruppen Coutaz, Section d’histoire, Université de Lausanne
Martin Grandjean, Section d’histoire, Université de Lausanne
Arthur Michelet, Section d’histoire, Université de Lausanne
Marten Düring, C²DH, Université du Luxembourg
Contact: martin.grandjean[at]unil.ch
Comité scientifique (par ordre alphabétique)
Alexander Badenoch (Utrecht University), Gabriele Balbi (Università della Svizzera italiana), Kaspar Beelen (University of London), Alain Clavien (Université de Fribourg), Pierre Evequoz (Université de Fribourg), Andreas Fickers (Université du Luxembourg), Richard Legay (Georg-August-Universität Göttingen), Johan Malmstedt (Umeå University), Jamie Medhurst (Aberystwyth University), Siân Nicholas (Aberystwyth University), Marie Sandoz (Université de Lausanne), Michael Stamm (Michigan State University), François Vallotton (Université de Lausanne), Nelly Valsangiacomo (Université de Lausanne), Hans-Ulrich Wagner (Leibniz Institute for Media Research, Hamburg).
Références
- Arceneaux, Noah. ‘The Ecology of Wireless Newspapers: Publishing on Islands and Ships, 1899-1913’. Journalism & Mass Communication Quarterly 91, no. 3 (2014): 562–77.
- Arceneaux, Noah. ‘The Wireless Press and the Great War: An Intersection of Print and Electronic Media, 1914–1921’. Journal of Radio & Audio Media 26, no. 2 (2019): 318–35.
- Bolter, Jay David, and Richard Grusin. Remediation: Understanding New Media. MIT Press, 2000.
- Cronqvist, Marie, and Christoph Hilgert. ‘Entangled Media Histories’. Media History 23, no. 1 (2017): 130–41.
- Delporte, Christian, Claire Blandin, and François Robinet. Histoire de la presse en France. XXe-XXIe siècles. Armand Colin, 2016.
- Drack, Markus T., ed. La radio et la télévision en Suisse. Hier+jetzt, 2000.
- Good, Katie Day. ‘Listening to Pictures: Converging Media Histories and the Multimedia Newspaper’. Journalism Studies 18, no. 6 (2017): 691–709.
- Hampton, Mark. Visions of the Press in Britain, 1850-1950. Urbana: University of Illinois Press, 2004.
- Jeanneney, Jean-Noël. L’écho du siècle. Dictionnaire historique de la radio et de la télévision en France. Fayard, 2001.
- Kaenel, Philippe. ‘Jack Rollan, homme de presse, homme-orchestre’. Revue Historique Vaudoise 129 (2021): 119–134.
- Koss, Stephen. The Rise and Fall of the Political Press in Britain. Volume 2: The Twentieth Century. University of North Carolina Press, 1984.
- MacLennan, Anne F. ‘Reading Radio: The Intersection between Radio and Newspaper for the Canadian Radio Listener in the 1930s’. In Radio and Society: New Thinking for an Old Medium, edited by Matt Mollgaard. Cambridge Scholars Publishing, 2012: 16-29
- Mäusli, Theo, and Andreas Steigmeier, eds. La radio et la télévision en Suisse. Hier+jetzt, 2006.
- Mäusli, Theo, Andreas Steigmeier, and François Vallotton, eds. La radio et la télévision en Suisse. Hier+jetzt, 2012.
- Müller, Kathrin Friederike, and Jutta Röser. ‘Convergence in Domestic Media Use? The Interplay of Old and New Media at Home’. In Media Convergence and Deconvergence, edited by Sergio Sparviero, Corinna Peil, and Gabriele Balbi. Springer International Publishing, 2017: 55–74.
- Nicholas, Siân. ‘Media History or Media Histories? Re-Addressing the History of the Mass Media in Inter-War Britain’. Media History 18, nos 3–4 (2012): 379–94.
- Sandoz, Marie. De l’orbite au territoire helvétique. Une histoire des communications par satellite en Suisse des années 1960 à nos jours. Alphil Presses Universitaires Suisses, 2025.
- Sebastián Morillas, Ana. ‘Publicidad y modelos sociales. La transmisión de modelos sociales en los distintos medios de comunicación tradicionales (prensa, radio y televisión) 1939-1975’. PhD thesis, Universidad de Valladolid, 2005.
- Sparviero, Sergio, Corinna Peil, and Gabriele Balbi, eds. Media Convergence and Deconvergence. Palgrave Macmillan, 2017.
- Stamm, Michael. Sound Business: Newspapers, Radio, and the Politics of New Media. University of Pennsylvania Press, 2011.
- Valsangiacomo, Nelly. Dietro al microfono. Intellettuali italiani alla Radio svizzera (1930-1980). Edizioni Casagrande, 2015.
- Willem, Guillaume. ‘« C’est une sorte de tirage que le tirage de la voix » ou l’écrivain interviewé : Au carrefour du discours littéraire et des médias de masse. Un enjeu générique (presse et radio françaises, 1891-1968)’. PhD thesis, KULeuven, 2020.